Par France Rioual.
Pourquoi ne pas profiter de l'engouement manifesté à l'occasion des JO de Paris pour se (re) mettre au sport ? Une petite course à pied, rien de tel pour démarrer la journée. Personnellement, je la pratique au petit matin quand les maisons sont engourdies et les rues désertes. Car si ce n’est le bienfait procuré après coup, l’exercice m’est assez insupportable. Davantage encore l’idée de me donner en spectacle : inspirant, soufflant, transpirant. Ne cours pas dignement qui veut...
La locomotive
Lui, n’en a rien à faire. Quand « il y a des coureurs qui ont l’air de voler, d’autres de danser… on dirait qu’il creuse comme un terrassier… » écrit Jean Échenoz dans le roman Courir qu’il lui consacre. « Loin de tout souci d’élégance… il progresse de façon lourde, torturée… il ne cache pas la violence de son effort qui se lit sur son visage crispé, tétanisé, grimaçant, continûment tordu par un rictus pénible à voir. » Le jour où l’image sera évaluée, il s’entraînera à sourire. C’est ce que répond en substance celui dont le corps semble être ni plus ni moins qu’une « mécanique détraquée, disloquée, douloureuse. » De l’avis des observateurs, c’est du n’importe quoi. Un n’importe quoi qui lui vaudra, entre autres, une triple médaille d’or aux jeux olympiques d’Helsinki en 1952 où il court le 5 000 m, le 10 000 m et les 42 kms du marathon. Lui, l’ex-employé d’usine de fabrication des chaussures Bata à Zlin en Tchécoslovaquie, qui avait le sport « en horreur » parce que « inutile et coûteux. » Lui, Émile Zatopek est de toutes les compétitions et pulvérise tous les records. Jusqu’au moment où le pays, après en avoir fait un instrument de promotion du communisme, s’interroge : « être un grand sportif populaire ne relèverait-il pas de l’individualisme petit bourgeois ? » Alors, « on se le garde, on se l’économise et on ne l’envoie plus trop à l’étranger.» Des fois qu’à l’occasion d’un de ses voyages, il ne soit tenté de rester de l’autre côté. Qu’à cela ne tienne, Émile, on ne peut plus l’arrêter. La locomotive, tel qu'il est surnommé, s’invente de nouveaux défis sur son territoire et s’entraîne à battre ses propres records.
Popularité inaltérable
Staline et Gottwald enterrés, les interdictions faites aux athlètes sont dénoncées. Émile entre à nouveau dans la course mais, à 33 ans, il commence à perdre. À chaque médaille gagnée, il avait été promu dans l’armée. Le voilà nommé colonel et recyclé en directeur des sports au ministère de la défense. Porté par Dubcek, un vent de liberté souffle sur le pays, loin du goût de la sœur aînée. Les chars soviétiques entrent à Prague. Émile rejoint les manifestants place Venceslas et en appelle au boycott de l’URSS aux Jeux Olympiques de Mexico. C’en est, évidemment, terminé de sa carrière militaire, il est expédié comme manutentionnaire dans les mines d’uranium. Plus tard, la sœur aînée qui a fait de Dubcek un jardinier, fait de Émile un éboueur. C’était sans compter sur une popularité inaltérée (inaltérable?) : il est acclamé dans les rues de Prague par une population qui se déplace pour vider elle-même ses poubelles. Émile Zatopek sera finalement improvisé archiviste dans les sous-sols du Centre d’Information des sports... Jean Échenoz situe son roman entre deux invasions : celle des Allemands en 1939 et celle des Soviétiques en 1968. Un récit parfaitement maîtrisé à l’humour décalé que je place, sans hésitation, sur la plus haute marche du podium. C
Le joyau
Elle, est la perfection incarnée. La précision, le risque, la puissance, le tout avec grâce. Époustouflante d’assurance et de maîtrise sans expression aucune sur le visage. Pas même lorsque, après l’épreuve, le tableau électronique affiche la note de 1. Un 10, cela ne s’était jamais vu en gymnastique. Le tableau ne l’avait pas programmé. Mais elle remporte bien la mise aux barres asymétriques, à la poutre et au tapis. Même que « certains juges auraient bien aimé aller au-delà, lui donner onze sur dix ! Douze renchérit aussitôt la juge canadienne. Ou qu’on invente de nouveaux chiffres ! Qu’on abandonne les chiffres. » rapporte Lola Lafon dans son roman La petite communiste qui ne souriait jamais. Elle, c’est Nadia Comaneci aux jeux olympiques de Montréal en 1976. 14 ans, 40 kilos, triple médaille d’or. Avec elle, (mais déjà avant avec Olga Korbut) on passe de la gym artistique à la gym acrobatique, « de l’image de la femme docile à celle de l’enfant amusante et douée ».
Bela Karolyi (roumain issu de la minorité hongroise du pays) a pour projet d’ouvrir une école expérimentale qui formera l’élite des gymnastes socialistes quand il repère Nadia. Elle a 7 ans. Dès lors, ses journées seront dessinées, ses repas calibrés, son sang disséqué, son urine scrutée. Les enchaînements sont répétés, démultipliés. Chaque soir, elle est réparée : anti-inflammatoires, anti-douleurs, corticoïdes. Mais Nadia est sérieuse, parfaite, imperturbable. "Si on la réprimande, elle écoute" jusqu’à la certitude d’être la meilleure. Nadia ne s’appartient plus. Quand les Soviétiques fulminent, "on ne va pas laisser la Roumanie nous humilier", Ceausescu en fait son joyau. Les chefs d'État se l'arrachent. Nadia est surveillée, exhibée, prêtée. Et dès lors que son corps se transforme : déconsidérée. Y compris lorsque ses performances confirment son excellence. Des années après son entraîneur, elle fuit à son tour la Roumanie pour rejoindre les États-Unis où un autre modèle de "marketabilité" l'attendra. En imaginant une correspondance fictive avec l'athlète, Lola Lafon évite tout manichéisme Est/Ouest. Son roman a reçu de nombreux prix dont le prix Ouest-France/ Étonnants Voyageurs. C
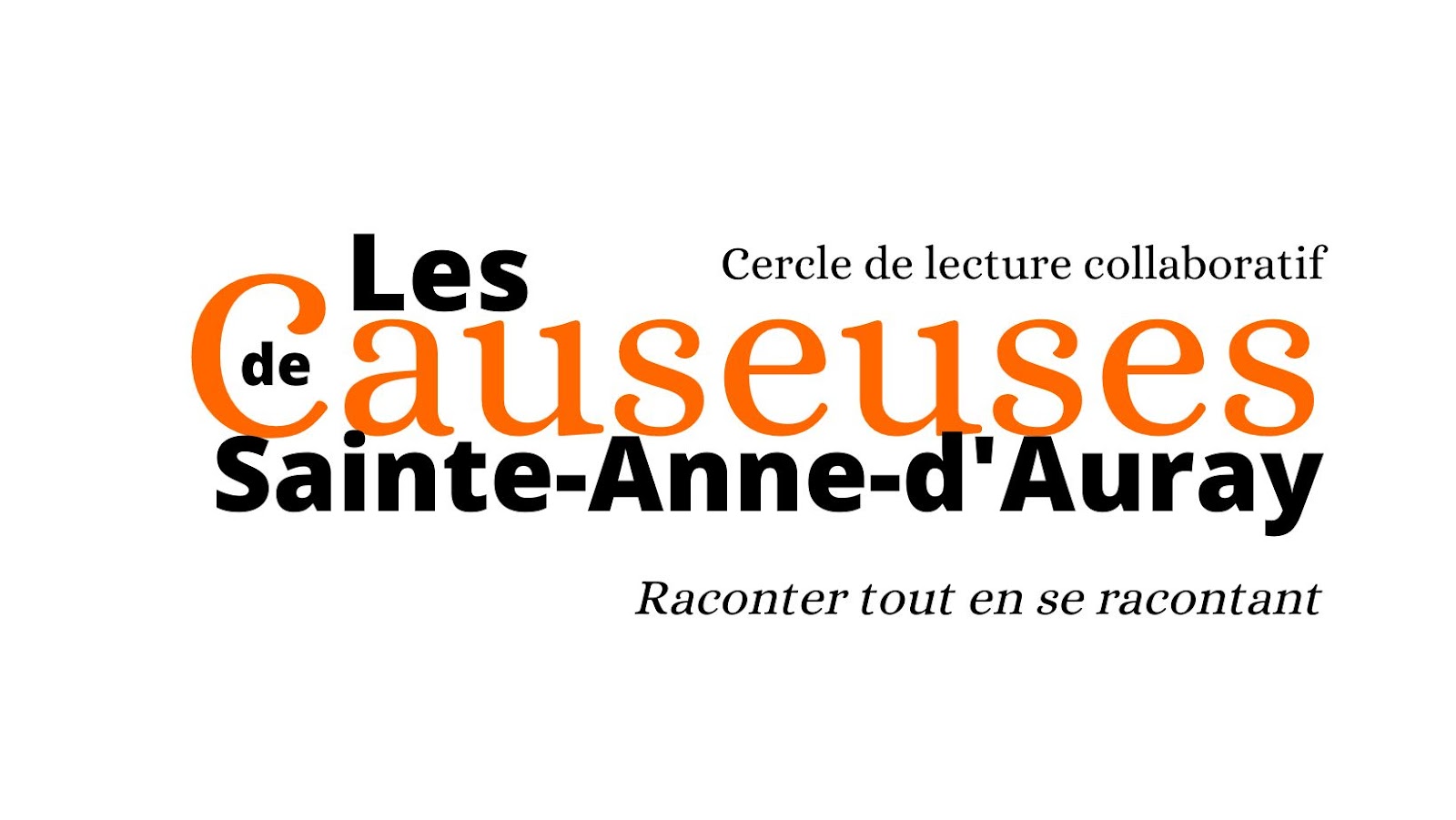

Commentaires
Enregistrer un commentaire