Par André Daviaud.
Des villes, je n’aime que leur passé. New York ne m’intéresse pas. Dans son style inimitable, Louis Ferdinand Céline décrit ainsi son arrivée à New York dans Voyage au bout de la nuit en 1932 : « Pour une surprise, c’en fut une. À travers la brume, c’était tellement étonnant ce qu’on découvrait soudain que nous nous refusâmes d’abord à y croire, et puis tout de même quand nous fûmes en plein dans la chose, tout galériens qu’on était, on s’est mis à bien rigoler en voyant ça droit devant nous. Figurez-vous qu’elle était debout leur ville, absolument droite. New York, c’est une ville debout. On en avait déjà vu nous des villes bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux mêmes. Mais chez nous, n’est-ce pas, elles sont couchées les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s’allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là l’Américaine, elle ne se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. » La métaphore est claire. New York est décrite comme virile et agressive, dressée pour une attaque, alors que les autres villes sont lascives et soumises, accueillantes, « une femme dans chaque port » comme diraient les marins. Je ne partage pas du tout la vision machiste de Céline mais, en 1932, New York est la première ville du monde à présenter tous ces gratte-ciel se dressant comme un défi au ciel. Pour l’auteur, elle est hostile.
Dubaï la prétentieuse
Je n’ai jamais voulu voir la grande arche de la Défense à Paris. Et je crois que je détesterais Dubaï, cette ville prétentieuse où les immeubles cherchent à défier la nature, cet orgueil des hommes à vouloir toujours plus de hauteur, de technique, de luxe. Tours de Babel. Une voyageuse qui revenait des Émirats m’a confié que ce qui l’avait le plus frappée là-bas, c’était la vie des émigrés qui édifient cette ville. Ils y mènent une existence parallèle, entassés dans de vieux bus pour aller au travail, entassés dans des logements misérables, labeur harassant, horaires interminables. Et, pourtant, ce sont eux qui construisent ces immeubles. Et leur vie misérable côtoie le luxe des touristes gavés d’attractions et celle des habitants gavés de pétrodollars.
Rome et Ostia Antica
J’ai aimé les ruines de Rome. Le Colisée, où l’on imagine les clameurs de la foule assistant aux spectacles sanglants, le forum où plane l’ombre de Cicéron prononçant ses diatribes à la tribune des rostres, où l’on devine le fantôme de César, assassiné dans la curie du Sénat. Apercevant parmi les meurtriers son fils adoptif, Brutus, il aurait dit : « Toi aussi, mon fils ! » Ce sont des colonnes solitaires qui se dressent dans le ciel, des murs effondrés, des arcs de triomphe au milieu des ruines. C’est la Rome qui régna plus de mille ans sur le monde, réduite aujourd’hui à l’état de vestiges. Nous avons aussi visité Ostia Antica, l’ancien port de Rome. Les Romains traçaient leur ville en partant de deux rues : le decumanus et le cardo. À partir de ces deux diagonales, les quartiers s’organisent. On devine les « insulae » (les immeubles), les temples, les villas urbaines dont plusieurs ont conservé leurs fresques ou leurs mosaïques. C’est une petite Pompei qu’Ostia Antica. À Rome, nous avons visité aussi des églises magnifiques, des musées aux œuvres grandioses, le château Saint-Ange, le Vatican... Cependant, le baroque nous a semblé très chargé, très massif, trop écrasant. Une plongée dans les Catacombes nous a fait rendre visite aux morts. Nous avons bien sûr goûté les gelatti, ces délices de glaces italiennes, les pastas, les pizzas authentiques. Mais Rome est une ville de voitures où il n’y a guère de place pour les piétons, une ville grouillante, cosmopolite, une grande ville quoi ! « La rue assourdissante autour de moi hurlait », écrit Baudelaire dans son poème : À une passante.
Villes en ruines
En fait, je crois que j’aime les villes en ruines, les villes dont on devine la grandeur passée. J’aurais sans doute détesté la Rome antique au sommet de sa gloire. Elle prend pour moi tout son charme quand elle n’est plus que souvenirs, que fantômes, que ruines dont on peut reconstituer la grandeur.
Diderot parlait de « la poétique des ruines ». Chateaubriand, dans Le Génie du christianisme, en 1802, a écrit : « Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence.» Sans doute suis-je un peu romantique. Mais, si j’aime les villes ruinées au fil du temps, je déteste les ruines barbares et brutales de la guerre. C
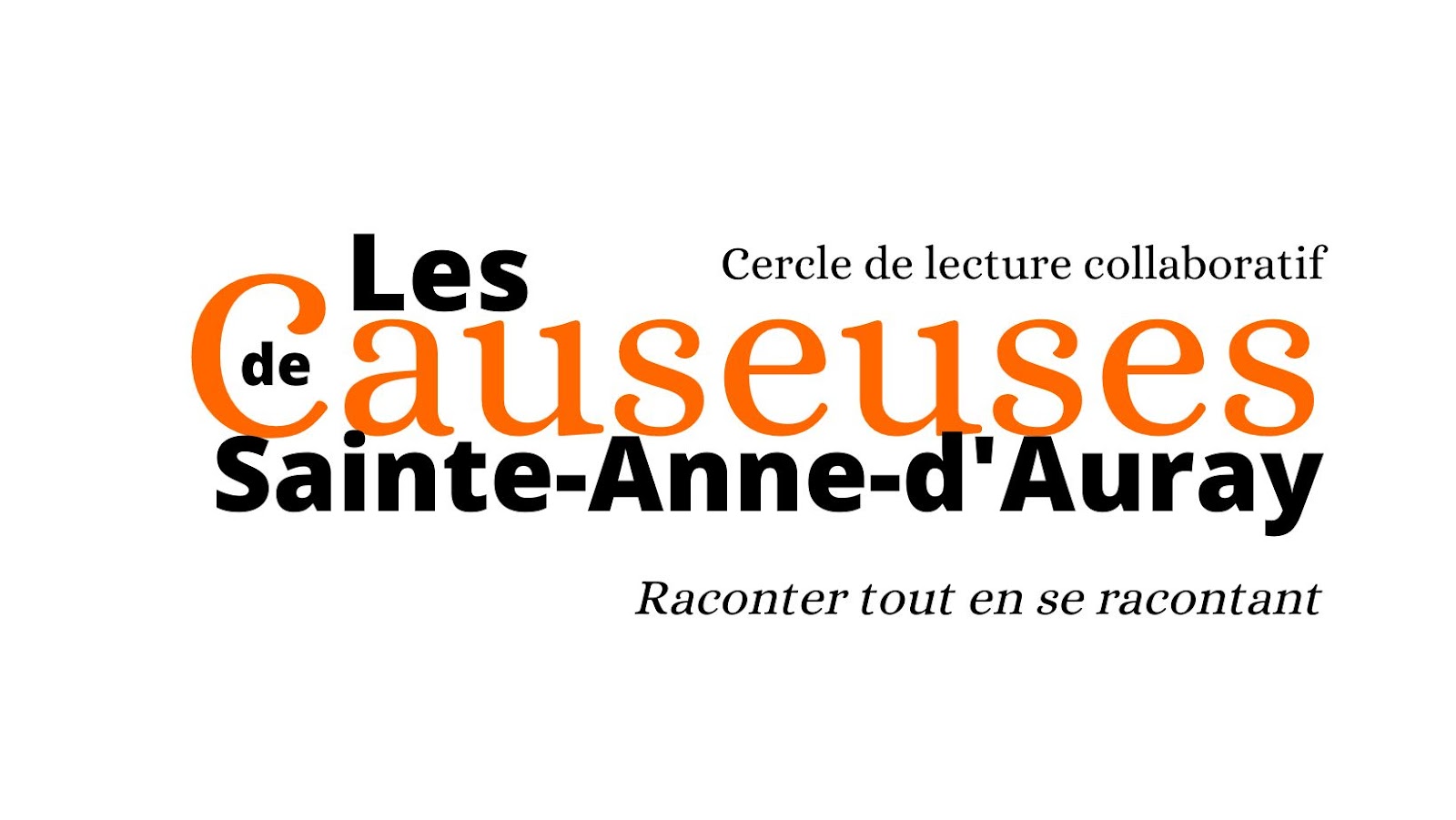

Commentaires
Enregistrer un commentaire