Une histoire récente
En France, sous l’égide de l’Association des Mutilés de France, le mouvement handisport connaît une importante évolution. En 1963, l’association devient Fédération Française sportive des Handicapés Physiques. En 1973, elle intègre le comité national olympique et sportif français. En 1977, elle devient la Fédération Française Handisport. Dès 1952, le handisport dans sa dimension internationale fut à la source de la création des jeux paralympiques. Il faut bien comprendre que sans la création de handisport, il n'y aurait pas de jeux paralympiques, tout au moins dans sa configuration actuelle, si remarquable.
Premiers paralympiques en 1960
En 1960, Rome accueille pour la première fois les jeux paralympiques quelques semaines après les jeux olympiques. Le défi fut immense: accueillir 400 athlètes en fauteuil roulant sans structures adaptées (!). Le mouvement prend de l’ampleur et amènera la création du comité paralympique international en 1989.
Destinés aux athlètes porteurs de handicaps, les jeux paralympiques se tiennent parallèlement aux jeux olympiques ; comme eux, ils ont lieu tous les quatre ans, après les jeux classiques, et dans les mêmes lieux.
14 disciplines en été, 6 en hiver
Les jeux actuels sont désormais ouverts aux handicapés visuels, amputés, infirmes moteurs cérébraux. Les athlètes porteurs d’un handicap intellectuel peuvent concourir dans trois disciplines : natation, tennis de table et athlétisme. Quatorze disciplines sont pratiquées lors des jeux paralympiques d’été, six disciplines lors des jeux d’hiver. La classification paralympique est réalisée par des professionnels du monde du handicap médical et technique qui ont pour mission d’évaluer l’impact du handicap sur le geste sportif. Ces évaluations sont encore sujettes à études et évolutions.
« Les jeux paralympiques sont dans la continuité d’un siècle de symboles et de valeurs universelles qui ont marqué l’histoire du sport et de l’humanité depuis 1896 » peut-on lire. Et en effet, les valeurs déclarées du mouvement paralympique sont le courage, la détermination, l’inspiration, l’égalité qui amènent le sens du partage, la citoyenneté, la consolidation du lien social. En France, le concept d’inclusion y répond parfaitement (loi 2002.2). Le drapeau paralympique représente trois vagues : rouge, verte et bleue s’encerclant sur fond blanc, appelées « agitos », du verbe latin agito : Je bouge. C
Murène de Valentine Goby
Au début, il y a l’accident. Hiver 1956, dans les Ardennes, sous la neige, François un grand beau garçon de 22 ans, en retard pour un rendez-vous, cherche un raccourci à travers les bois ; trompé par la neige, il croise une voie ferrée qu’il croit désaffectée. Il grimpe sur un wagon pour la traverser. "Une déflagration fracture le ciel." François n’est pas mort mais ses bras sont carbonisés au-delà des épaules. Le chirurgien qui le prend en charge ne gardera pas l’ombre d’un moignon. Dans un parcours douloureux, François lutte avec l’envie de "se foutre en l’air". Jusqu’à ce moment où, visitant l’aquarium de la Porte Dorée, il découvre " une silhouette grossière, sans écailles, ni nageoires, une séquelle du fond des âges... une vision de cauchemar… une murène. " " C’est moi " dit-il. Poursuivi par cette image obsédante, il prend contact avec l’Amicale Sportive des Mutilés de France puis la Fédération Sportive des Handicapés et, en 1962, ce sont les grandes compétitions internationales suivies des jeux paralympiques. À l’impossible, François s’est tenu. C
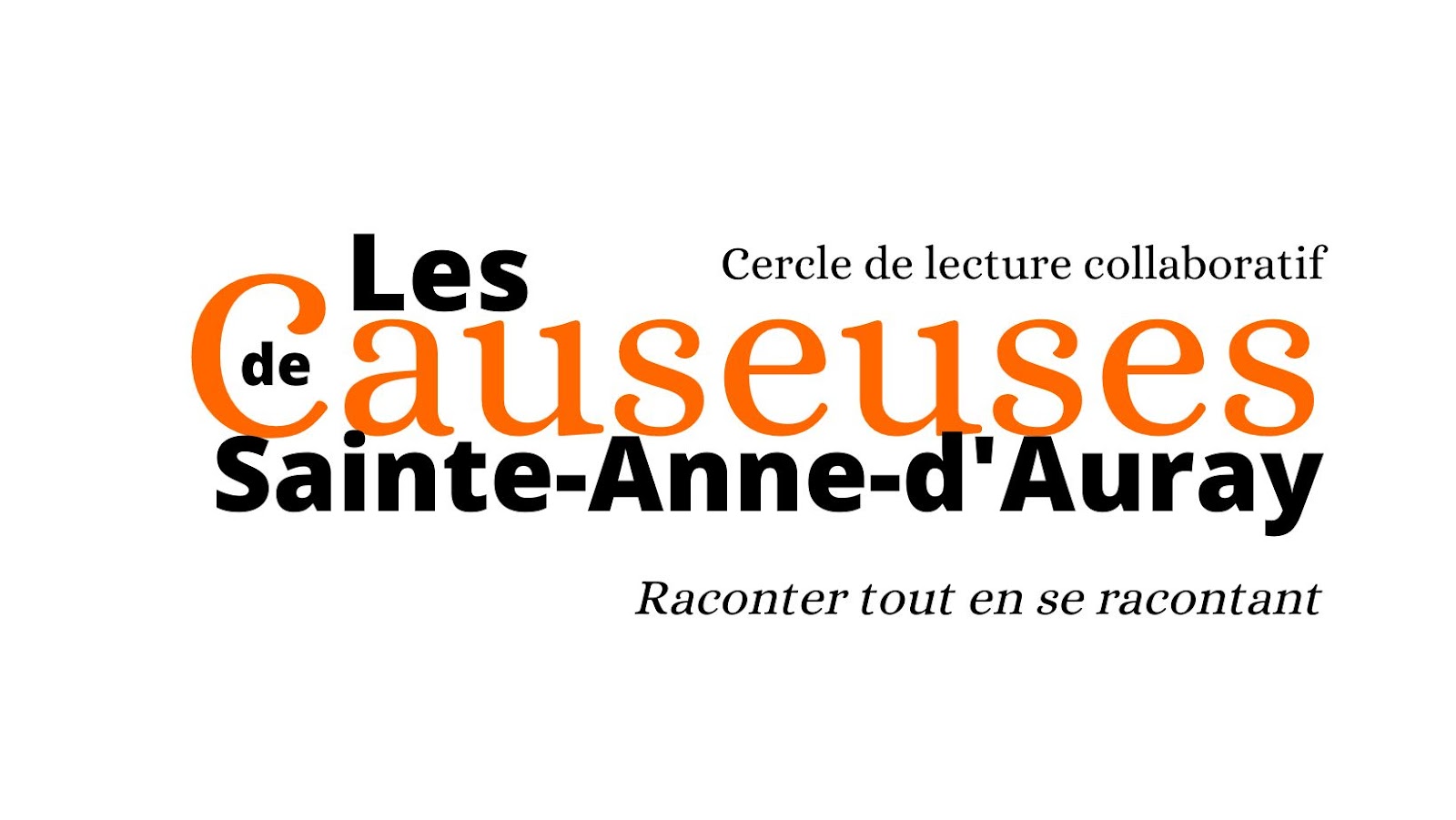

Commentaires
Enregistrer un commentaire