Par André Daviaud.
J’ai une passion pour deux livres de Marguerite Duras. Ce sont des ouvrages d’autofiction, c’est-à-dire des récits où se mêlent fiction et autobiographie. Ces deux œuvres sont Un barrage contre le Pacifique et L’Amant.
À la fin de l’Amant, la petite de quinze ans quitte l’Indochine de son enfance. Elle y abandonne ce qui fut toute sa vie, et aussi l’amant chinois. Elle pleure en cachette :
« Elle aussi c’était lorsque le bateau avait lancé son premier adieu, quand on avait relevé la passerelle et que les remorqueurs avaient commencé à le tirer, à l’éloigner de la terre, qu’elle avait pleuré. Elle l’avait fait sans montrer ses larmes, parce … qu’il était chinois et qu’on ne devait pas pleurer ce genre d’amants. »
La séparation d’avec la terre
C’est le départ d’un paquebot pour l’Europe. Duras y décrit le lent détachement du grand bâtiment qui rejoint le delta du Mékong et s’éloigne peu à peu jusqu’à disparaître à l’horizon sous le regard et les pleurs de ceux qui restent : « Les départs. C’était toujours les mêmes départs. C’était toujours les premiers départs sur les mers. La séparation d’avec la terre s’était toujours faite dans la douleur et le même désespoir, mais ça n’avait jamais empêché les hommes de partir, les juifs, les hommes de la pensée et les purs voyageurs du seul voyage sur la mer, et ça n’avait jamais empêché non plus les femmes de les laisser aller, elles qui ne partaient jamais, qui restaient garder le lieu natal, la race, les biens, la raison d’être du retour. Pendant des siècles les navires avaient fait que les voyages étaient plus lents, plus tragiques aussi qu’ils ne le sont de nos jours. La durée du voyage couvrait la longueur de la distance de façon naturelle. On était habitué à ces lentes vitesses humaines sur la terre et sur la mer, à ces retards, à ces attentes du vent, des éclaircies, des naufrages, du soleil, de la mort. »
Pour des raisons sans doute littéraires, elle regrette la beauté et la lenteur de ces éloignements, qui faisait de ces départs une longue agonie des adieux, un déchirement puisque le bateau mettait des semaines à rejoindre la France, des semaines à éloigner ceux que l’on aimait et que l’on ne reverrait peut-être jamais : « À cette époque-là, et ce n’est pas encore si loin, à peine cinquante ans, il n’y avait que les bateaux pour aller partout dans le monde. De grandes fractions des continents étaient encore sans routes, sans chemins de fer. Sur des centaines, des milliers de kilomètres carrés il n’y avait encore que les chemins de la préhistoire. C’était les beaux paquebots des Messageries Maritimes, les mousquetaires de la ligne, le Porthos, le D’Artagnan, l’Aramis, qui reliaient l’Indochine à la France. »
Ce genre d’homme
L’amant chinois ne s’est pas montré, mais son automobile est là, stationnée à l’écart sur le port. C’est une longue voiture noire, un véhicule de riche, de cette richesse qui a séduit la petite au moment de leur rencontre sur le bac qui traverse le Mékong. Mais si l’amant est riche, il est Chinois. Et la petite blanche ne doit pas fréquenter ce genre d’homme. Sa blancheur l’en empêche. Et puis, elle a quinze ans. L’amant la regarde du fond de l’habitacle. La longue automobile noire symbolise à la fois tous les souvenirs de leur liaison scandaleuse et la mort de cet amour. C’est le corbillard qui porte le deuil de cette expérience décisive et douloureuse. Marguerite Duras n’est plus jamais revenue en Indochine.
L’Amant a obtenu le Prix Goncourt en 1984. Depuis, je n’ai pas lu un Goncourt qui m’ait tant bouleversé, à la fois par la magie de son langage, et par son thème.
Même en littérature, tout grand départ n’est-il pas un déchirement ?
Au cinéma
Le roman L’Amant a fait l’objet d’une adaptation en film par Jean-Jacques Annaud en 1992. Marguerite Duras devait en faire le scénario. Mais elle ne s’est pas entendue avec le réalisateur. Cinéaste elle-même, elle avait une conception très différente du cinéma, à cent lieues d’une adaptation qu’elle jugeait commerciale. Elle a écrit en 1991, L’amant de la Chine du nord, roman-scénario dans lequel elle développe la façon dont elle conçoit le film qu’on pourrait tirer de L’Amant. C
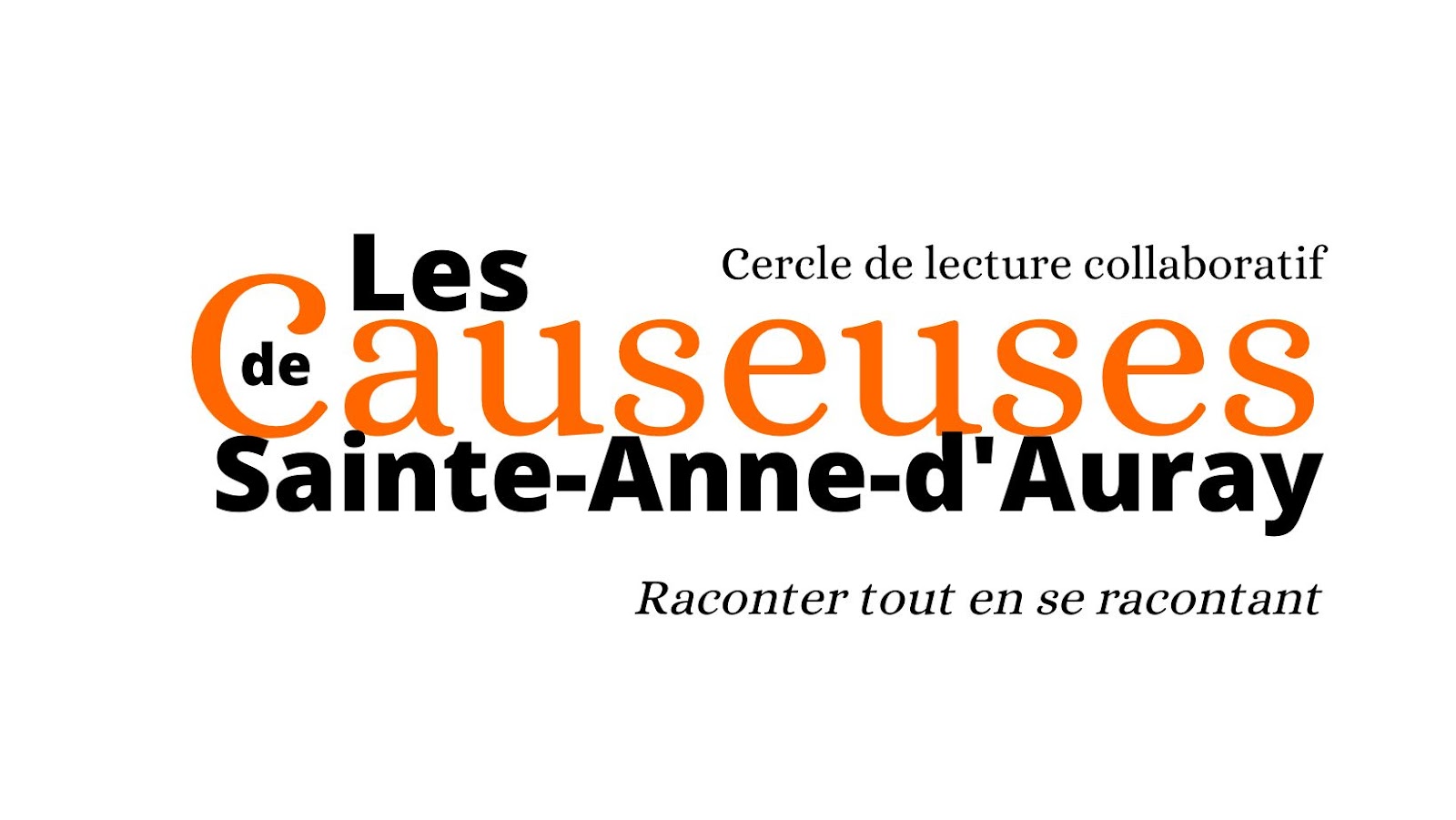

Commentaires
Enregistrer un commentaire