La Causeuse : La découverte des sépultures de Téviec pourrait en soi servir d’intrigue à un roman. D’ailleurs, en préambule au vôtre, vous faites, judicieusement, apparaître l’un des archéologues à l’origine de la découverte. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce dénommé Saint-Just Péquart ?
André Daviaud : Saint-Just Péquart est un quincaillier de Nancy qui a fait fortune dans l’industrie du béton armé. C’est aussi un amateur d’art qui voue une passion à l’archéologie de la Préhistoire. Il n’est pas seul. Avec Marthe, sa femme, et leurs trois enfants, ils fouillent pendant leurs vacances d’été, d’abord aux côtés de Zacharie Le Rouzic à Carnac. Une brouille avec l’archéologue amènera la famille à poursuivre ses recherches non loin de là à Téviec (plus tard à Hoëdic). Leur démarche est scientifique. Photographies et vidéos à l’appui, les lieux sont scrupuleusement étudiés. En 1928, stupéfaction : treize sépultures sont mises à nu. La famille pense avoir affaire au Néolithique, l’Institut de Paléontologie Humaine rattache les 23 squelettes découverts au Mésolithique ! Il y a 7 000 ans ! Une autre dimension ! La découverte est d’autant plus remarquable que ce sont les seuls en Bretagne où l’acidité du sol détruit jusqu’aux os. Ici, entourés d’amas coquilliers, les squelettes ont été protégés par une gangue de calcaire pendant des milliers d’années. En 1940, Saint-Just Péquart entre dans la milice pétainiste par anti-communisme viscéral. Il sera fusillé en septembre 1944. Cela va jeter le discrédit sur ses découvertes. Ce n’est qu’à partir des années 90, qu’une nouvelle génération d’archéologues, parmi lesquels Grégor Marchand, vont ressortir de l’oubli les derniers chasseurs-cueilleurs d’Occident.
La Causeuse : Les communautés que vous mettez en scène dans votre roman - les chasseurs-cueilleurs appelés « les Hommes qui marchent » et les agriculteur-éleveurs dénommés « les Immobiles »- sont scrupuleusement décrites, comme le ferait un ethnologue. Le lecteur est plongé dans des façons de faire (s’abriter, se nourrir, se vêtir) et de vivre (aimer, décider) situées au Mésolithique. Mais si l’ethnologue a pour coutume de vivre au sein de la communauté qu’il étudie, d’évidence vous n’avez pas partagé la vie des Hommes qui marchent ? Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour donner vie à vos personnages ?
André Daviaud : L’archéologie d’abord. Des traces qui font sens, que ce soit les sépultures de Téviec ou les marques d’un habitat à Quiberon. Les huttes décrites dans le roman sont celles du site préhistorique de Beg-Er-Vil à Quiberon. L’ethnologie ensuite, avec la connaissance des peuples premiers à travers notamment des travaux comme ceux de Lévi-Strauss. L’histoire enfin. Les conditions de la disparition des chasseurs-cueilleurs est une question. Ont-ils de plein gré adhéré à cette nouvelle civilisation d’agriculteurs-éleveurs ou ont-ils été contraints par ces derniers. Pour ma part, j’ai opté pour la seconde hypothèse. Si on observe l’histoire que ce soit en Amérique du Sud, du Nord, en Afrique, en Asie, aucune colonisation ne s’est faite sans violence. À partir du moment où une civilisation est convaincue de sa supériorité, c’est ainsi. Elle anéantit l’autre. À la fin du Mésolithique le pays est totalement occupé par les agriculteurs-éleveurs.
La Causeuse : Vous dédicacez votre ouvrage à l’archéologue Grégor Marchand, spécialiste du Mésolithique décédé prématurément, mais aussi « à tous ceux qui luttent pour leur survie ». Dans le roman deux civilisations se télescopent que tout oppose. L’une vénère la nature tandis que l’autre prétend la dominer. L’une prend appui sur les compétences, l’autre sur la possession. L’une nourrit empathie, l’autre envie. Se pourrait-il que notre société capitaliste ait pris racine au Mésolithique ?
André Daviaud : C’est une théorie. La hiérarchie est née de la possession. À chaque conquête, le chef est celui qui s’approprie le plus de terres possible. Plus on avance dans le temps, plus on s’est approché de ce type de société. C’est ce qu’on appelle aussi l’impérialisme. Il ne faut pas cependant nier les avantages de la multiplication. Les réserves de nourriture fournies par l’agriculture-élevage ont entraîné un mieux être. Comme il ne faut pas idéaliser les conditions de vie des chasseurs-cueilleurs. Elles étaient précaires. Ils n’étaient jamais certains du lendemain et souffraient de carences. Meurtres d’enfants et anthropophagie sont soupçonnés en période de disette.
La Causeuse : Les femmes ont toute leur place dans le roman. Vous évoquez « l’éclatante égalité dont (elles) jouissaient dans le clan ». En diriez-vous autant de la place de la femme dans la société d’aujourd’hui ?
André Daviaud : Les chasseurs-cueilleurs vivaient en petits groupes de 20 à 30 individus. Tout le monde participait à la chasse. L’agriculture-élevage voit naître et survivre plus d’enfants qui cantonnent davantage les femmes au foyer. De là naît la domination masculine. Aujourd’hui si l’égalité figure dans la loi, force est de constater que dans les faits la réalité est autre. Et je ne parle pas de la situation catastrophique des femmes là où prospèrent religion ou nationalisme poussés à leurs extrêmes.
La Causeuse : Le décor est planté. Reste les ficelles du romancier à tirer, ce que vous faites avec beaucoup de poésie. Jalousie, trahison, amour et courage ponctuent les aventures du dernier clan de Téviec « … qui se savait désormais privé des départs fiévreux pour la chasse et de l’enivrement des traques sous l’égide des dieux des forêts que les Immobiles bafouaient. » Le roman est aussi une porte d’entrée dans la Préhistoire que l’on ne peut que conseiller. Les sépultures de Téviec sont-elles visibles aujourd’hui ?
André Daviaud : l’Histoire et la Littérature sont intimement liées. Il n’y a pas d’œuvre littéraire qui ne soit intégrée dans un contexte, une période historique. Et oui, on peut voir les sépultures de Téviec. Elles ont été dispersées sur différents sites : Saint-Germain-en-Laye, Toulouse, Carnac où, au musée de Préhistoire (auquel le nom de Zacharie Le Rouzic a été rattaché), se trouve une salle consacrée aux Péquart. C
André Daviaud, outre plusieurs recueils de poésie, est l’auteur de La Terre à personne, Un sourire solaire, Mané Véchen, Une guerre interdite, Face aux fusils, les événements dramatiques de Sainte-Anne-d’Auray, août 1944 et Le dernier clan de Téviec. À venir les enfants de Mané Véchen avec La petite fille qui voulait égaler les Dieux et Le garçon qui venait du Nord. Après une carrière de professeur de lettres, André Daviaud se dit en retraite mais pas en retrait. Il fait aussi partie du comité de rédaction des Causeuses.
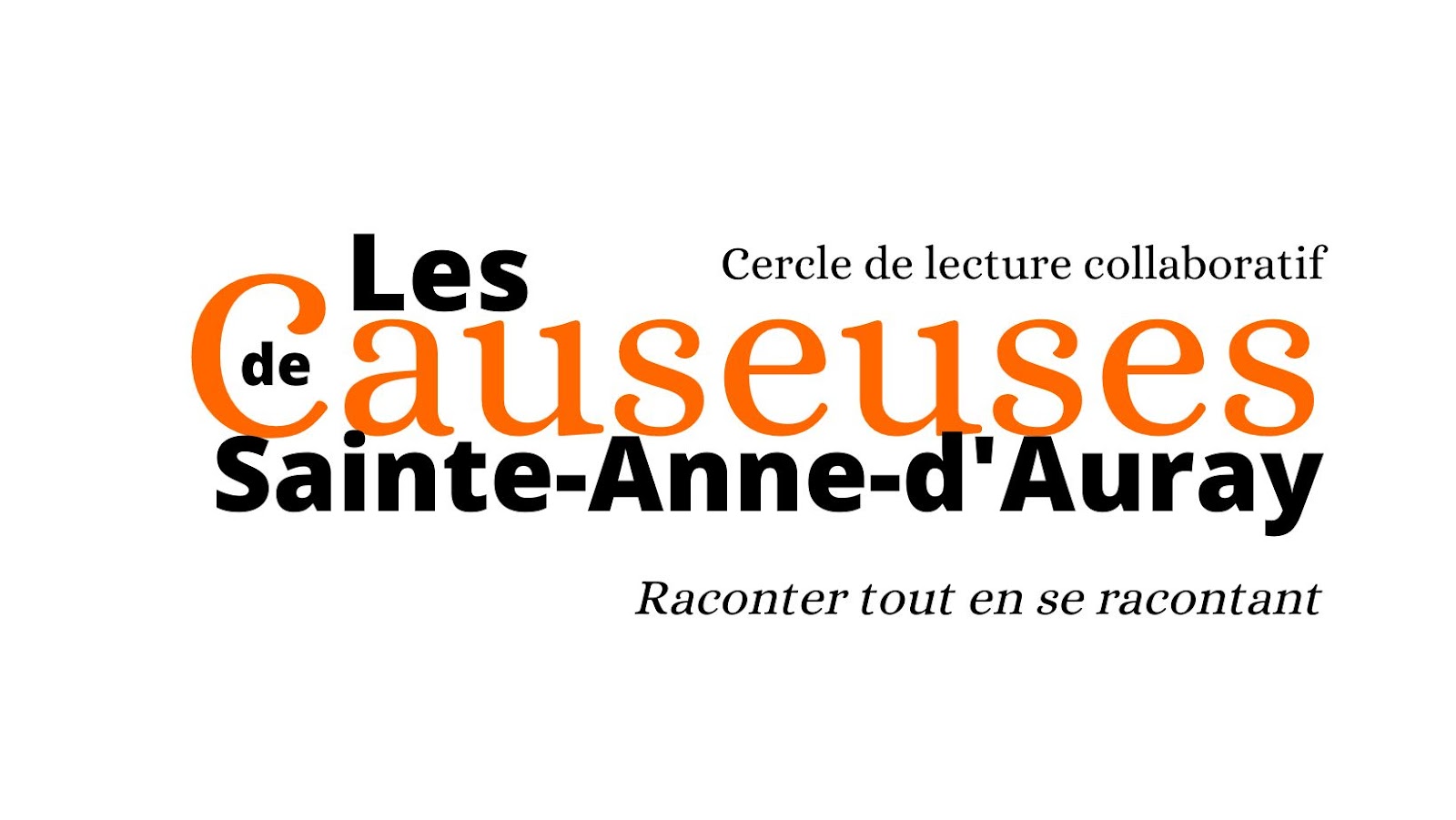

Commentaires
Enregistrer un commentaire