Je vous emmène découvrir La Maison de Matriona, nouvelle écrite par Alexandre Soljénitsyne dans les années 50, d'inspiration autobiographique et publiée en 1963.
Ignatitch, le narrateur veut « s'enfoncer et se perdre dans les entrailles même de la Russie » après 10 ans de prison en Goulag. Il obtient un poste d'enseignant de mathématiques dans un village. C'est chez Matriona, femme âgée et seule, qu'il décide de prendre pension, malgré l'état de son izba. Jugez plutôt : « les copeaux (du toit) pourrissaient, les rondins du corps et le portail, autrefois imposants, étaient gris de vétusté, et le revêtement s'était effrité. » Outre une petite cuisine séparée par une cloison et cachée par un vieux rideau, il n'y a qu'une pièce de vie. « Son lit à elle était dans le coin de la porte, près du poêle ; je dressai mon lit de camp près d'une fenêtre et, écartant de la lumière les chers ficus de Matriona, je mis une petite table devant une autre fenêtre. (...)Les pluies ne faisaient pas encore crouler la toiture(...) »
Des souris et des cafards
Dans cette maison, il y a aussi un chat, des souris et des cafards. « Entre les rondins et la peau de papiers peints, les souris s'étaient fait leurs voies et froufroutaient insolemment, courant là-dedans même au plafond. (…) Dans la salle les cafards n'allaient pas. Par contre dans la cuisine, la nuit, ça grouillait et si, y entrant le soir pour boire de l'eau, j'allumais l'électricité, tout le plancher et le grand banc et même le mur étaient bruns presque partout et remuaient. »
Malgré ces conditions de vie rudimentaires, Ignatitch est bienveillant envers Matriona, il accepte les repas toujours semblables : pommes de terre ou « soupe de terre » ou encore bouillie d'orge perlé. « Ce n'était pas toujours salé à point, souvent brûlé, cela laissait une pellicule sur le palais, les gencives, et donnait des maux d'estomac. Mais ce n'était pas la faute de Matriona, il n'y avait pas de beurre à acheter, on s'arrachait la margarine, et on n'avait à volonté que des graisses animales. (…) Je m'en accommodais parce que la vie m'avait appris à voir le sens de l'existence quotidienne dans autre chose que dans le manger. J'attachais plus de prix au sourire de son visage arrondi. » Tous deux vont s'apprécier mutuellement. Matriona est toujours prête à aider voisins ou parents sans en attendre de retour. Sa vie a été dure, elle a perdu 6 enfants en bas-âge, la maladie la rattrape parfois, mais elle reste souriante à la vie malgré tout…
Un beau portrait de femme
Un jour, son beau-frère vient lui réclamer « la chambre », une pièce à l'étage promise après sa mort à sa fille adoptive Kira, mais, par cupidité, il vient la démonter pour l'emporter chez son fils, mari de Kira. Au cours du trajet de nuit, un drame survient où Matriona perd la vie. Après les funérailles, la maison de Matriona sera encore partagée...
Outre la vie d'un petit village rural communiste, où la pauvreté oblige à frauder, où mesquineries familiales et commérages ne sont pas rares, A. Soljénitsyne nous offre un beau portrait d'une femme pourtant jugée insignifiante, raillée et méprisée par son entourage, mais qui au fond est une belle personne, incomprise, « ce Juste dont parle le proverbe et sans lequel il n'est village qui tienne. Ni ville. Ni notre terre entière. » C
Alexandre Soljénitsyne, La maison de Matriona, Ed. Julliard 1963, Le Livre de Poche 1965, 64 p.
Alexandre Soljenitsyne (1918-2008) a obtenu le Prix Nobel de littérature en 1970. Ses œuvres les plus connues sont Le Pavillon des cancéreux (1968) et L'archipel du Goulag (1974-1976).
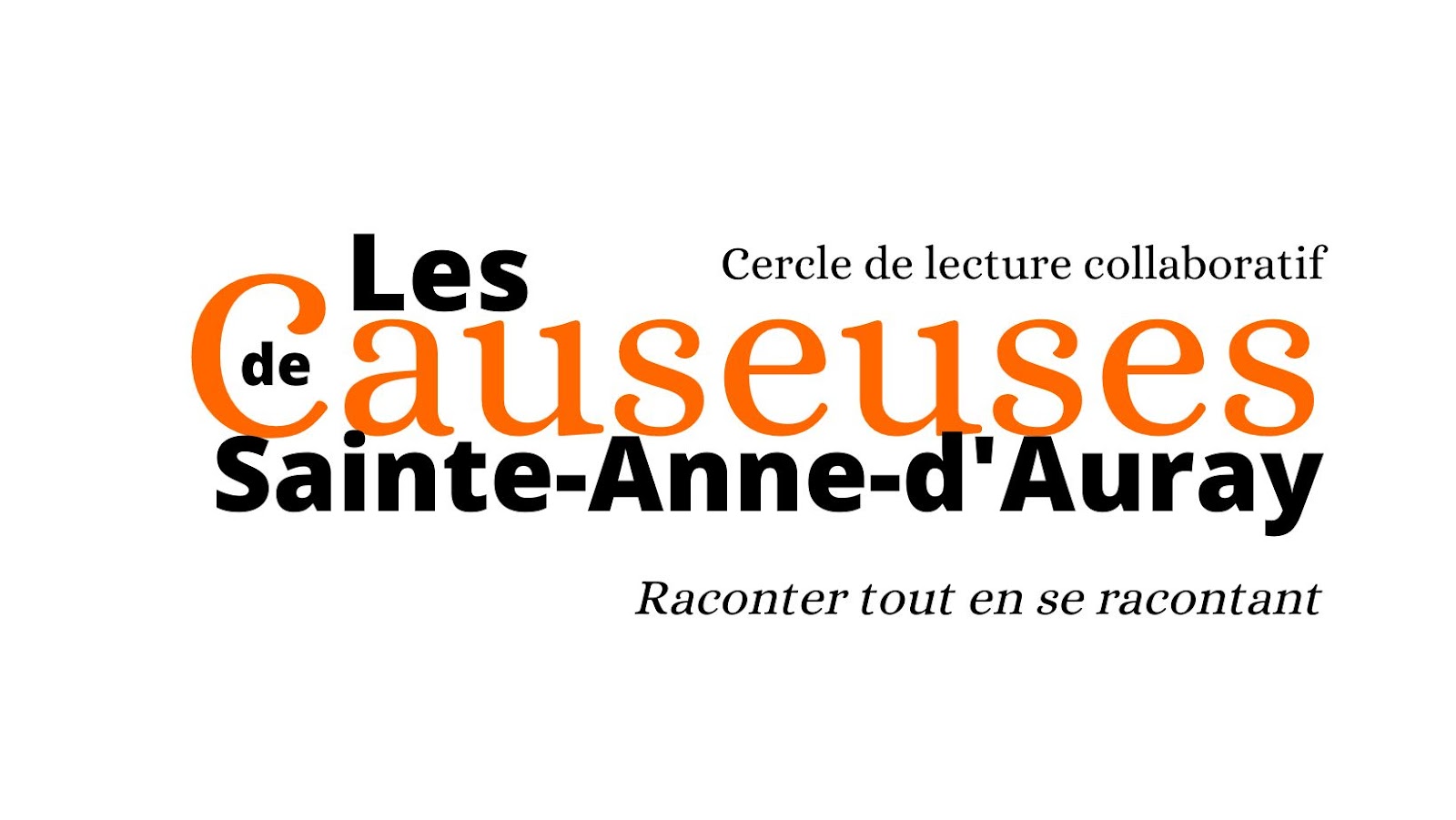

Commentaires
Enregistrer un commentaire