Par France Rioual.
J’ai voyagé. Un peu. Accompagnée. Seule aussi. Dans ce cas de figure, ma décision (sans appel) de partir a toujours suscité des réactions. Qu’est-ce que j’allais faire là-bas ? Avais-je conscience des dangers que j’allais rencontrer ? Et les enfants ? Je pensais à mes enfants ?
Tout ceci m’est revenu en mémoire à la lecture de Les femmes aussi sont du voyage, l’émancipation par le départ. Cette impression de transgresser le rôle et la place qui m’étaient assignés bientôt doublée d’un sentiment de culpabilité puisque j’avais l’inconscience de persévérer dans mon projet de voyage. Rien de bien original en fait. C’est ce que révèle l’autrice Lucie Azéma dans son petit essai sorti en 2021 et dont je conseille vivement la lecture à toutes celles qui seraient sur le point de renoncer.
La peureuse ou la sulfureuse
De tout temps nous apprend-elle les femmes ont voyagé. Et l’on ne parle pas des seules Alexandra David-Néel, Ella Maillard ou autre Anita Conti devenues de véritables légendes auxquelles il est difficile de s’identifier tant elles ont réalisé d’exploits. Non, celles dont il est question ici sont celles qui, bien que s’étant aventurées sur les routes ont été -sont- totalement invisibilisées par la société. Qui sait, ces voyageuses-aventurières pourraient mettre à mal ce que les mythes fondateurs nous ont transmis. Ulysse parcourt le monde. Pénélope attend. Ulysse enchaîne les exploits. Pénélope élève Télémaque. Avec son tissage à n’en plus finir, elle est un modèle de vertu quand le mot même d’aventurière est longtemps synonyme de femme sulfureuse qui court les aventures beaucoup plus qu’elle ne part à l’aventure.
Une école de la virilité
Les attendus de la société en matière de voyage varient selon que vous êtes un homme ou une femme. Liberticides pour les unes, ils servent la position dominante des autres. Le voyage est un pré-carré, voire une fabrique de la masculinité. Lucie Azéma nous invite à une autre lecture des Pierre Loti, Jack Kerouac ou autre Sylvain Tesson. Tout comme elle m’a incitée à noter scrupuleusement les noms (totalement inconnus pour ma part) de celles qui ont osé : Mary French Sheldon, Nellie Bly, Ida Pfeiffer (si attachante), Sarah Marquis, Catalina de Erauso, Gloria Steinem et tant d’autres.
Une vision tronquée
Une fois surmontés les commentaires paternalistes et passés outre les ricanements misogynes, force est de constater que ces voyageuses ont une expérience autre de l’aventure. Bien que souvent disqualifié, leur vécu témoigne de situations absentes dans les récits des écrivains-voyageurs soit parce que considérées sans intérêt soit parce qu’ils n’y ont tout simplement pas accès. Il est très prégnant encore ce moment où ma fille et moi avions été invitées à assister aux préparatifs nuptiaux de la mariée lors d’un périple en famille au Maghreb. Laissant fistons/frères et mari/père au bord de la route, nous avons partagé des moments inoubliables de confidences et de complicité avec les femmes de la maison qui nous mèneront jusqu’à notre premier hammam situé au coeur de leur quartier.
Du mépris de genre au préjugé raciste
Cette occultation des écrivaines-voyageuses vaut aussi pour les écrivains-voyageurs issus des pays traversés. Lucie Azéma pointe notre chronologie eurocentrée du voyage. Qui ne connaît pas Marco Polo, Christophe Colomb, Vasco de Gama ? Mais qui connaît, pour ne citer qu’un, Ibn Battûta ? Les voyageurs européens ont, aussi, porté un regard dominant sur les pays qu’ils traversaient. Et la colonisation est un éloquent cas d’école quand on parle d’aventure et de masculinité. Porter un regard avec l’autre plutôt que sur lui, c’est tout ce qu’on peut souhaiter à toutes les futures voyageuses, écrivaines ou pas écrivaines. Concernant la démarche, la voyageuse Lucie Azéma n’ a aucun doute là-dessus car, nous dit-elle : « refuser d’être dominée, c’est refuser de dominer ».
Pas que des écrivaines
Jusqu’au 5 novembre, le musée de Pont-Aven proposait une exposition qui illustre parfaitement tout ce qui vient d’être dit précédemment. Artistes voyageuses, L’appel des lointains 1880-1944, était son nom et c’est aussi le nom du catalogue sorti à cette occasion. Il retrace le combat qu’a été celui des femmes artistes peintres et sculptrices pour accéder à la formation d’abord. Les Beaux-Arts et la participation au Prix de Rome leur ont été longtemps refusés. Il présente ensuite le parcours de quelque 35 artistes pour la plupart tombées dans l’oubli. Si le contexte colonial de l’époque a servi les modalités de voyage de certaines (pas toutes loin de là), leurs œuvres tranchent de façon flagrante avec les représentations faites jusqu’alors des pays parcourus. C
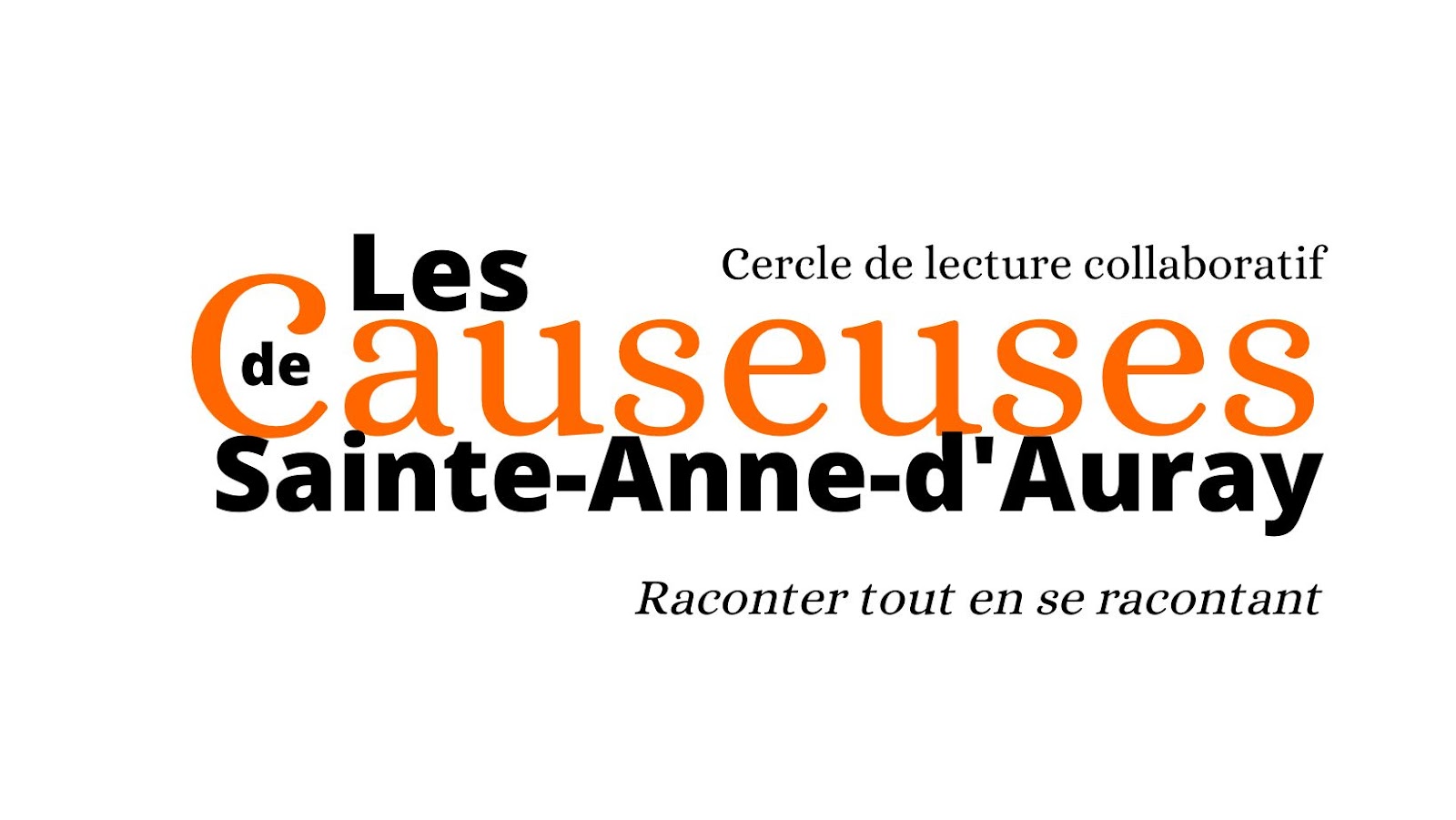

Commentaires
Enregistrer un commentaire