Par France Rioual
C’est en 2011 que, pour la première fois, j’y ai déplacé ma tribu. Le festival du film de Douarnenez consacrait, cette année-là, sa 34ème édition à l’Afrique du Sud, aux peuples minoritaires d’Afrique du Sud. Car c’est sa marque de fabrique, les minorités, celles qu’on maltraite et bafoue, celles qu’on voudrait faire taire et rayer de la carte mais aussi celles qui ont décidé de résister et de combattre. Depuis, ladite tribu a été sensibilisée au sort des Catalans, des Roms, des sourds, des Papous, des intersexes, des Kurdes, des Romanches… des Bretons. Et s’il lui vient à manquer le festival, il y a comme un arrière-goût d’incomplétude à la fin de l’été. Outre une programmation de documentaires et de fictions réalisés par des figures autochtones marquantes, le festival propose chaque jour (rendez-vous à 18h sous le chapiteau !) une rencontre-débat. Animées par des universitaires, des journalistes, des réalisateurs et des auteurs, ces conférences additionnées les unes aux autres, vous assurent de repartir en fin de semaine, avec une idée générale sur la situation des peuples invités. Cet été, la 45ème édition sera consacrée aux premiers peuples d’Amérique du Nord.
Des mots sur des faits
Depuis plusieurs éditions maintenant, le festival, en plus d’ouvrir sur place une librairie éphémère (des centaines de titres choisis par une équipe de bénévoles) multiplie les interventions littéraires. Ce qui, parole de Causeuse, ajoute à votre point de vue un regard complémentaire et vous incite à placer des mots sur des faits.
Comme une introduction à la 45ème édition, je dirais que, dans Payer la terre de Joe Sacco, ces mots sont acculturation, assimilation et génocide culturel. L’auteur, américano-maltais, revient dans son édifiante BD documentaire sur les processus à l’oeuvre dans la disparition, en trois générations, de la culture et de la langue des premières nations des territoires du nord-ouest canadien. Les pensionnats autochtones, qui ont récemment défrayé la chronique*, sont une arme de choix dans l’éradication. Mis en place par le gouvernement canadien et gérés par les Églises, ces institutions ont pour objectif de rompre le lien parental et par delà interdire la transmission d’une culture et d’une langue ancestrales. L’éducation des enfants enlevés à leur famille est basée sur le dénigrement et la culpabilité. Les mauvais traitements sont légion. Pratiqué dès 1850, le placement des enfants autochtones est rendu obligatoire à partir de 1920 et sera effectif jusqu’au milieu des années 90.
La terre ne nous appartient pas
Le traumatisme est grand pour les peuples à l’origine nomades qui vivent de la pêche et de la chasse. Soucieux qu’ils sont de préserver l’harmonie avec la terre et les animaux, ils n’entendent, par ailleurs, pas grand-chose aux traités successifs sur lesquels le Canada s’appuie pour exploiter les territoires du nord ouest où pétrole et gaz, argent et diamant sont découverts à la fin du 19ème siècle. « Les hommes blancs sont venus et ont voulu la partager avec nous mais… La terre ne nous appartient pas. C’est nous qui lui appartenons.» Reste que, officiellement, les populations « céderont » les terres qu’ils foulaient depuis des temps immémoriaux contre « quelques dollars, une poignée d’outils et de médailles pour ceux qui se disaient leurs chefs. » Elles se sédentarisent en devenant salariées des entreprises. Et quand ces dernières ne jugent plus l’affaire rentable et quittent le paysage, c’est un peuple désorienté et consumé par les drogues et l’alcool qu’elles laissent sur place. Le plus dramatique sans doute dans cette histoire richement étayée par les très nombreux témoignages recueillis par Joe Sacco, est l’intériorisation par les peuples autochtones de la prédominance occidentale. L’arme est redoutable. Justifiée, pour certains, par la volonté de ne pas faire vivre à leurs enfants ce qu’ils ont vécu, elle amène d’autres à reproduire jusqu’aux mauvais traitements subis.
Composer avec son passé
On le devine au fil du récit. C’est avec un tel passé que doivent composer les personnages du captivant roman choral de Katherena Vermette Les femmes du North End. L’action se situe dans le North End, quartier défavorisé de Winnipeg, capitale de la province canadienne de Manitoba, où vivent des « gens biens » mais aussi « des gangs, des prostitués et des drogués. » La distinction n’épargne pas les nombreux Amérindiens, « autorisés à quitter leurs réserves », qui y résident. Quatre générations de femmes entrent en scène lorsque l’une d’entre elles est victime d’un sordide fait-divers. Composer est leur lot quotidien : avec leurs origines, leur difficile intégration sociale et professionnelle, leurs addictions, la fuite de leurs compagnons, le racisme et la misogynie. Composer ? À une exception prêt : on ne touche pas à leurs enfants. C
* un article de TV5 Monde/décembre 2021 révèle la découverte de 215 petites dépouilles aux abords d’un pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique.
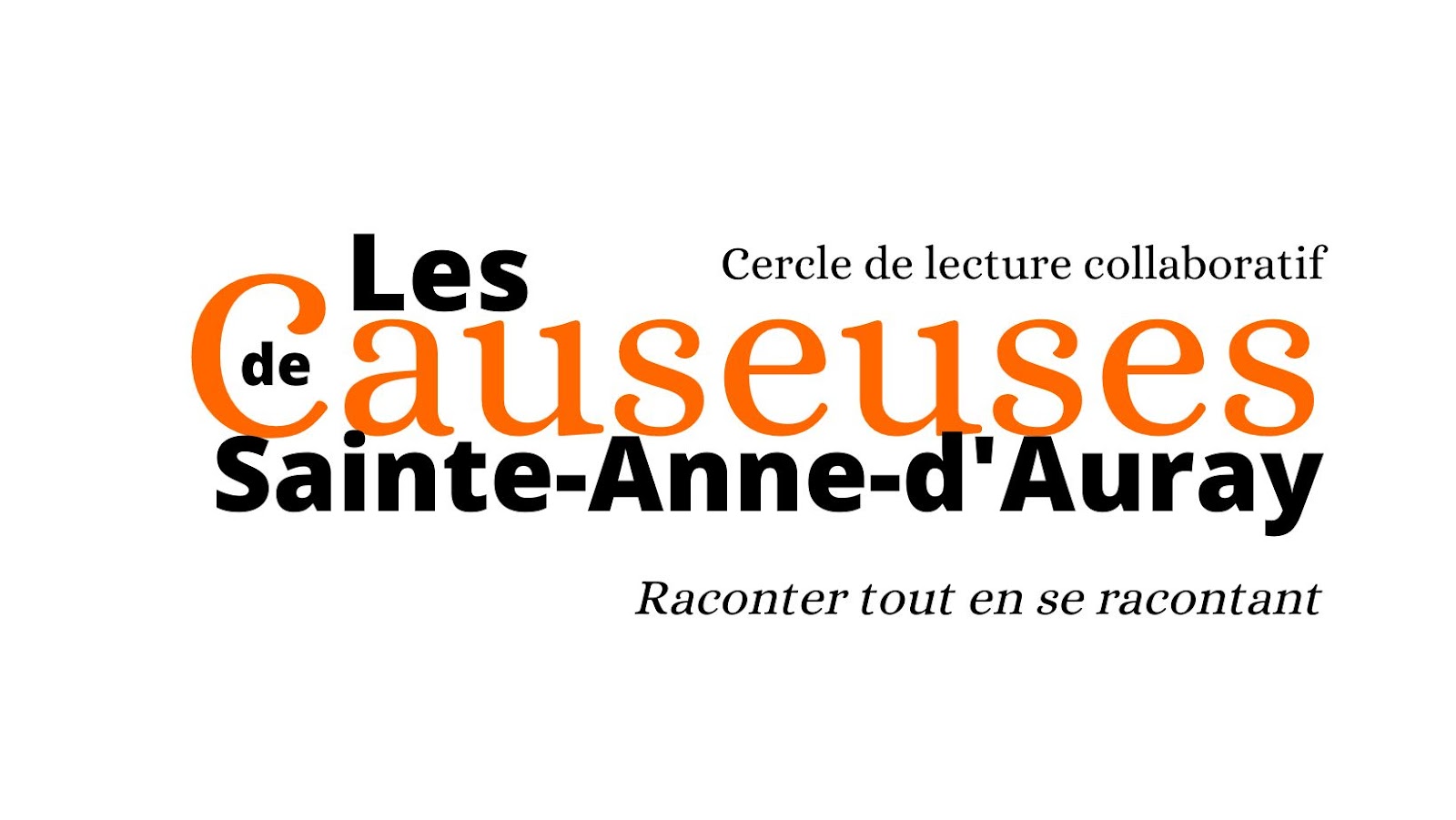

Commentaires
Enregistrer un commentaire